Apprendre le chinois et le japonais,
les langues de nos voisins
Jean François BILLETER
Le Nouveau Quotidien, 21 juin 1994
Branle-bas chez les sinologues, indianologues et japonologues. La montée en puissance économique des pays d’Asie orientale laisse à la Suisse dix ans pour ouvrir ses écoles, ses universités à leurs langues et à leurs cultures. Le plaidoyer de Jean François Billeter, professeur à l’Uni de Genève.
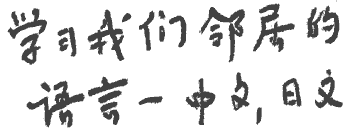
traduction en chinois du titre de l’article
Dans un rapport paru il y a quelques semaines, le Conseil suisse de la science juge alarmant l’état de l’enseignement des études asiatiques en Suisse. Pourquoi?
Jean François BILLETER: Les facultés de Lettres ont créé des enseignements – études chinoises, japonaises et indiennes à Zurich, chinoises et japonaises à Genève, indiennes et bouddhiques à Lausanne -, mais ce sont des enseignements de Lettres centrés sur les langues et les civilisations. Ce qui manque, on s’en aperçoit aujourd’hui avec la montée en puissance des économies de l’Asie orientale et l’engagement de l’économie suisse dans cette partie du monde, ce sont des formations permettant de combiner la connaissance de ces pays et de leurs langues avec des connaissances de droit, d’économie, de sociologie. Pour créer ces filières, d’autres facultés doivent prendre le relais et compléter ce qui a été fait. Il faudra trouver des formules nouvelles car le chinois et le japonais ne s’apprennent pas comme une langue européenne : un étudiant débutant ne connaît rigoureusement rien d’une langue dont l’apprentissage est très ardu. Il est comme un enfant… Et il y a l’écriture.
LNQ: On entend dire que la Suisse a manqué sa chance, dans les années 50, lorsqu’elle était un des rares pays à entretenir des relations diplomatiques avec la Chine…
A l’époque, la Chine était partie intégrante du bloc socialiste et la Suisse très anticommuniste. Quand pour la première fois je suis allé dans ce pays en 1963, on me donnait pour perdu. La Chine est devenue plus proche avec la révolution culturelle. Ce fut le premier moment d’alerte dans l’opinion publique suisse. Elle a ensuite sombré dans une crise politique qui l’a longtemps rendue inintelligible. L’étape suivante, considérable, fut son entrée à l’ONU en 1971, qui débouchera sur l’ouverture économique depuis le début des années 80.
Comment faire, alors, pour rattraper le temps perdu?
Il y a trois grandes idées:
La première consiste à créer le plus rapidement possible les nouvelles filières dont je viens de vous parler. Cela pourrait prendre la forme, par exemple à Genève, d’un enseignement d’économie chinoise. On pourrait aussi imaginer un cours sur les institutions politiques de la Chine et du Japon, On pourrait commencer par des chargés de cours, plus tard des chaires.
Mais d’ici une génération, ces pays seront littéralement nos voisins et il faudra pouvoir communiquer avec eux comme on le fait aujourd’hui avec les États-Unis.
La deuxième est très importante : il s’agit de créer des cours propédeutiques d’une année d’enseignement de chinois et japonais, accompagnée de cours sur le pays. Cette année préalable serait exigée des étudiants qui voudraient ensuite étudier ces domaines à l’université… En ayant cette bonne base de départ ils pourraient ensuite, bien plus vite qu’actuellement, aborder des matières véritablement intéressantes. Ces cours seraient aussi ouverts à tous ceux – diplomates, hommes d’affaires, journalistes – qui en ont besoin dans leur travail. Pour ces élèves-là, les cours seraient payants. J’imagine trois heures quotidiennes de cours de langue accompagnés d’une initiation aux réalités contemporaines et à l’histoire de la Chine et du Japon. Il pourrait y avoir aussi des exercices en laboratoire de langues. Après huit mois en Suisse, un stage de perfectionnement de deux mois dans le pays.
La troisième idée, c’est celle d’un institut suisse de l’Asie orientale…
L’enseignement actuel en Lettres souffre d’un sous-développement terrible. Prenez mon exemple : je devrais être compétent pour enseigner le chinois moderne et classique, la littérature, la philosophie, la religion. C’est humainement impossible. À terme, pour faire du travail sérieux, il faudra disposer en Suisse d’au moins une ou deux chaires de littérature, d’une ou deux chaires de philosophie et de religions, d’histoire. Le Conseil suisse de la science recommande qu’il y ait au moins cinq ou six chaires consacrées à la Chine, réparties entre Genève et Zurich, selon un plan préétabli. Contre deux aujourd’hui.
Quant à l’Institut, qui pourrait être mis sur pied bientôt, il serait une structure de coordination : il recevrait des fonds pour la recherche d’origine publique ou privée, organiserait des échanges et des collaborations scientifiques. Surtout, son existence témoignerait de la volonté de la Suisse d’agir et nous faciliterait la tâche dans nos relations avec ces pays.
Mais alors pourquoi ne pas fonder un institut, géographiquement bien situé, où se concentreraient tout le savoir et les compétences ?
Parce que cela coûterait cher et que l’on créerait ainsi une arche de Noé de spécialistes de l’Asie. Au contraire, pour que le plus grand nombre possible de gens bénéficient de cette ouverture sur les réalités asiatiques, il faut que ces dernières soient présentes dans toute l’Université, dans les écoles.
On dira que vous en demandez beaucoup en même temps qu’on sent, notamment dans les entreprises, que les besoins sont considérables…
La Chambre de commerce Suisse-Japon est de celles qui aimeraient qu’on ouvre des cours de langue et de culture japonaises dès l’automne 1995. Je comprends cette impatience, mais cela n’ira pas si vite. Il ne faut pas seulement parer au plus pressé, Depuis quelques années, les entreprises recourent à des spécialistes qui viennent d’Allemagne ou d’Angleterre, qui coûtent parfois très cher et qui satisfont leurs besoins. Comme certaines d’entre elles envoient leurs cadres suivre des cours intensifs à Hongkong ou ailleurs. Cela, c’est le court terme. Mais il y autre chose que les entreprises. Il est tout aussi important qu’il y ait dans les universités suisses des gens qui se forment, qui réfléchissent et plus tard forment d’autres gens. Au fond, la Suisse doit comprendre qu’un monde nouveau est en train de naître dans lequel la Chine, l’Inde et le Japon seront nos voisins, nos concurrents ou nos partenaires dans toutes sortes de domaines, pas seulement dans celui des affaires.
Pour entrer en contact avec eux, il faudra que nous parlions leurs langues, ne serait-ce que pour prendre connaissance du savoir que leurs scientifiques accumulent. Quand je vais à Pékin, je suis surpris par le nombre de jeunes Occidentaux qui parlent le chinois. Les Chinois l’apprécient et s’y habituent. La même évolution a lieu au Japon.
L’Europe a longtemps vécu d’une rente de situation qui lui a value sa prédominance à l’ère coloniale. Elle a imposé ses langues, ses scientifiques, Cette période touche à sa fin. Et il y a une dimension dont nous n’avons pas parlé : la valeur formatrice des études chinoises, japonaises ou indiennes, sur le plan de la formation intellectuelle de la personne…
Propos recueillis par Michel ZENDALI
| L’impatience des entreprises et les idées des pionniers
À la Chambre de commerce Suisse-Japon, inévitablement installée à Zurich, Lydia Lehmann applaudit aux projets des sinologues et japonologues suisses. « Mais il faut aller vite » ajoute-t-elle, exigeant par exemple que les cours intensifs de langues commencent à la rentrée 95 déjà. Cette impatience est à la mesure des besoins grandissants des entreprises en cadres qui possèdent davantage que des rudiments des deux principales langues de l’Orient. « Dans une négociation avec une entreprise japonaise, cette dernière est toujours représentée par plusieurs personnes. Si son interlocuteur occidental ne saisit par leurs conciliabules, il perd des atouts essentiels. » C’est si vrai que, lors de ses deux premiers cours d’été sur la civilisation nippone, la Chambre a eu la surprise de voir débarquer rien de moins que l’ambassadeur de Suisse au Japon et un haut fonctionnaire de l’Office fédéral des affaires économiques extérieures. Michel ZENDALI |
